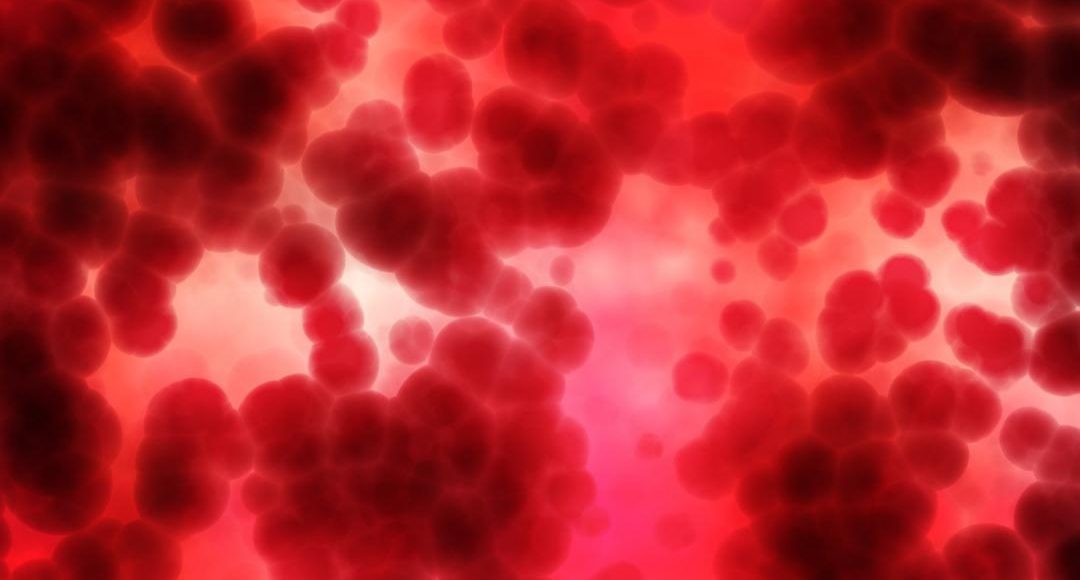Une équipe de chercheurs du Baylor College of Medicine (États-Unis) a mis en lumière une piste thérapeutique aussi inattendue que prometteuse dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Leurs travaux révèlent que certaines altérations spécifiques dans la composition du sang pourraient protéger le cerveau des effets dégénératifs de cette pathologie. Publiés dans la revue Neuron, ces résultats ouvrent la perspective d’une nouvelle approche préventive fondée non plus sur le cerveau lui-même, mais sur la modulation du milieu sanguin.
L’étude repose sur la comparaison de souris modèles atteintes d’Alzheimer avec d’autres génétiquement modifiées pour y résister. Les chercheurs ont identifié des différences notables dans les protéines circulant dans leur sang. En transférant le plasma des souris protégées à celles atteintes, ils ont observé des améliorations significatives de la mémoire et une diminution de l’inflammation cérébrale, l’un des moteurs clés de la neurodégénérescence.
Ces résultats suggèrent l’existence de facteurs circulants capables de ralentir — voire d’inverser — certains processus pathologiques associés à Alzheimer. Ils viennent renforcer une hypothèse désormais centrale en neurosciences : le cerveau est en interaction constante avec le reste de l’organisme, et notamment avec le système immunitaire et les composés biologiques véhiculés par le sang.
Les molécules précises responsables de cet effet protecteur n’ont pas encore été formellement identifiées, mais les chercheurs évoquent déjà un potentiel thérapeutique considérable. Si ces mécanismes peuvent être reproduits chez l’humain, on pourrait imaginer des traitements non invasifs, administrés de manière précoce, capables de freiner le déclin cognitif avant l’apparition de symptômes irréversibles.
Cette approche s’inscrit dans une tendance émergente de la recherche biomédicale, qui relie vieillissement, immunité et santé cérébrale. Elle laisse entrevoir que certaines personnes résistent peut-être naturellement à Alzheimer non pas en raison d’une protection neuronale locale, mais grâce à un équilibre biologique systémique, encore mal compris.
Alors que la maladie d’Alzheimer touche aujourd’hui plus de 50 millions de personnes dans le monde et reste sans traitement curatif, la plupart des thérapies expérimentales ciblent les dépôts amyloïdes ou les protéines tau, avec des résultats décevants. L’idée d’agir indirectement, via le sang, représente une stratégie complémentaire novatrice, qui pourrait renouveler en profondeur la prise en charge de la maladie.
Encore à un stade préclinique, ces travaux pourraient pourtant initier une nouvelle ère dans la prévention des maladies neurodégénératives. Demain, un simple test sanguin pourrait permettre de dépister précocement le risque d’Alzheimer et de proposer des traitements personnalisés, capables de moduler les signaux circulants bien avant que les lésions cérébrales ne deviennent irréversibles. Une avancée qui redonne à la recherche un souffle d’espoir face à un défi médical mondial.
Ouiza Lataman