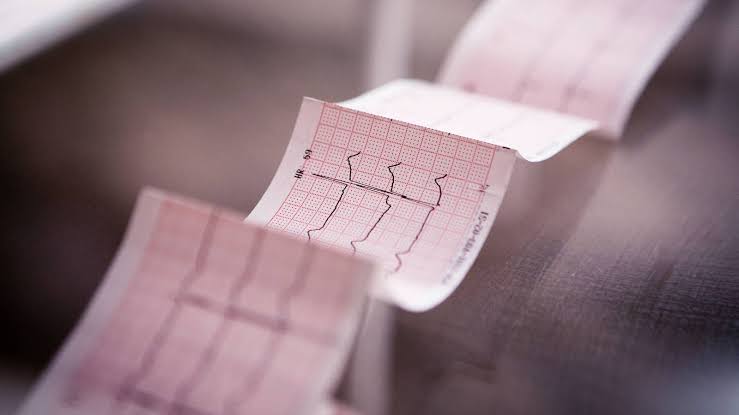Une équipe de chercheurs franco-espagnole identifie une molécule d’origine intestinale favorisant la formation de plaques d’athérome, posant les bases d’un nouveau paradigme en cardiologie préventive.
Et si le risque d’infarctus se jouait aussi… dans l’intestin ? C’est la piste audacieuse qu’explore une étude d’envergure, publiée dans la revue Nature, par des chercheurs du Centre national de recherches cardiovasculaires (CNIC) de Madrid, en collaboration avec l’Institut Pasteur. Leur découverte : un métabolite issu de la flore intestinale, le propionate d’imidazole (ImP), jouerait un rôle déterminant dans le développement de l’athérosclérose — principale cause des infarctus.
Ce composé est produit lorsque certaines bactéries intestinales métabolisent un acide aminé essentiel, l’histidine, abondamment présent dans les aliments riches en protéines. Mais c’est la concentration excessive de cette molécule qui inquiète : les chercheurs ont démontré que l’ImP favorise l’apparition de lésions précoces sur les parois des artères, un processus clé dans l’installation de l’athérosclérose.
Chez la souris, l’administration chronique d’ImP par voie orale a suffi à provoquer l’accumulation de dépôts lipidiques dans les artères. Chez l’humain, des taux élevés de cette molécule ont été relevés chez des patients à haut risque cardiovasculaire — bien avant l’apparition de symptômes cliniques.
Au-delà de sa portée explicative, l’ImP pourrait devenir un biomarqueur majeur. Actuellement détectable uniquement via des technologies de pointe comme la spectrométrie de masse (LC-MS), les chercheurs espèrent développer des outils de dépistage plus accessibles — pourquoi pas, à terme, une simple analyse sanguine intégrée au bilan cardiovasculaire standard.
Mais l’étude ne s’arrête pas là. L’équipe a également identifié un récepteur immunitaire, I1R, activé par l’ImP, comme maillon central de cette cascade inflammatoire. Chez l’animal, bloquer pharmacologiquement ce récepteur a permis de freiner — voire d’empêcher — la formation des plaques d’athérome, même en présence d’un régime riche en cholestérol.
Ce récepteur ouvre ainsi la voie à de nouvelles approches thérapeutiques, qui viendraient compléter les traitements hypocholestérolémiants actuels, en ciblant un mécanisme inédit : l’interaction entre microbiote intestinal, système immunitaire et paroi vasculaire.
Cette avancée s’inscrit dans le mouvement plus large de la médecine de précision, qui considère chaque individu dans toute la complexité de son environnement, de son alimentation, et de son microbiote. Elle rappelle également que le cœur ne se résume pas à une simple pompe mécanique : il réagit à ce que nous mangeons, aux microbes que nous hébergeons, et à l’équilibre subtil entre inflammation, métabolisme et immunité.
« Nous ne soupçonnions pas à quel point certaines molécules issues du microbiote pouvaient influencer directement l’inflammation vasculaire », explique David Sancho, auteur principal de l’étude. « C’est une porte d’entrée nouvelle, et nous ne faisons qu’en effleurer le potentiel. »
L’identification du propionate d’imidazole comme facteur déclencheur de l’athérosclérose pourrait bien changer la donne en matière de prévention cardiovasculaire. Elle offrirait la possibilité de détecter plus tôt les individus à risque, et de développer des traitements ciblés sur des mécanismes encore largement inexplorés.
Longtemps cantonné à la sphère digestive, le microbiote s’impose désormais comme un acteur central de la santé cardiovasculaire — et peut-être, de notre longévité.
Amina Azoune