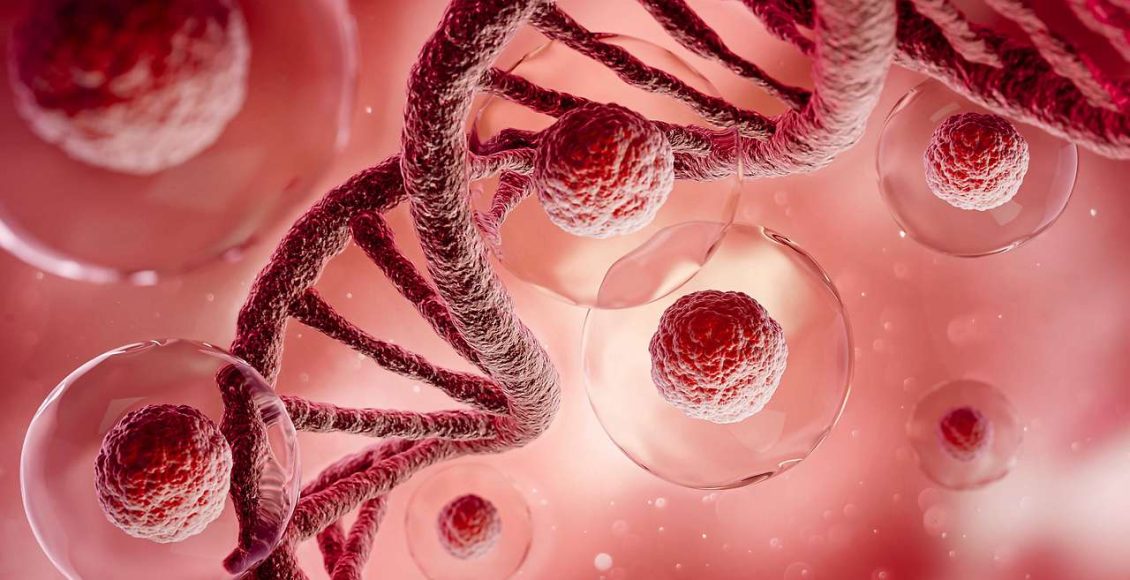Le temps laisse son empreinte partout, y compris dans le plus fluide de nos organes : le sang. Dans une étude publiée ce mois-ci dans la prestigieuse revue Nature, une équipe de chercheurs espagnols lève le voile sur les mécanismes invisibles qui président au vieillissement de notre système sanguin. À l’aide d’une technique inédite baptisée EPI-Clone, les scientifiques sont parvenus à retracer la trajectoire des cellules souches du sang sur plusieurs décennies, sans recourir à la moindre manipulation génétique.
Le secret de leur approche ? Les marques épigénétiques, ces minuscules modifications chimiques de l’ADN, véritables “codes-barres” biologiques, qui s’accumulent au fil du temps dans chaque cellule. En les décodant, les chercheurs ont pu reconstituer l’arbre généalogique des cellules sanguines, identifiant, chez l’humain comme chez la souris, une tendance inquiétante : avec l’âge, une poignée de clones cellulaires finit par dominer la production du sang.
Cette expansion clonale, longtemps suspectée, est ici observée avec une précision inédite. Elle ne résulte pas toujours de mutations cancéreuses. Elle serait, selon les auteurs, un phénomène naturel du vieillissement. Mais cette domination de quelques clones se paie cher : la diversité cellulaire diminue, la réponse immunitaire s’émousse, et le terrain devient plus propice à des affections graves, notamment hématologiques.
« C’est comme si quelques familles devenaient propriétaires de l’ensemble du réseau sanguin. Moins de diversité signifie moins de résilience face aux agressions », résume le Dr Iñaki Martín-Subero, co-auteur de l’étude.
Les résultats sont d’autant plus frappants qu’ils révèlent des anomalies bien avant qu’aucun symptôme ne soit détectable cliniquement. Chez des souris âgées, certains clones dominants ne produisent même plus de cellules matures, accentuant un déséquilibre dans la production du sang. Ce déficit qualitatif pourrait expliquer en partie la vulnérabilité croissante des personnes âgées face aux infections et à certains cancers.
Mais l’étude ne s’arrête pas au constat. Elle ouvre des pistes concrètes : en surveillant régulièrement ces “codes-barres” épigénétiques, il serait théoriquement possible d’identifier les déséquilibres clonaux bien en amont d’une pathologie manifeste. À terme, cette technologie pourrait être intégrée à des stratégies de dépistage, voire de médecine préventive personnalisée.
Reste la question du coût. Aujourd’hui, l’analyse complète revient à environ 5 000 euros. Mais les chercheurs espèrent ramener ce montant à 50 euros, grâce aux progrès du séquençage et de l’intelligence artificielle.
Cette avancée, fruit d’une collaboration entre le Centre de régulation génomique (CRG) et l’Institut de recherche biomédique (IRB) de Barcelone, pourrait bien marquer un tournant dans notre compréhension du vieillissement. Et rappeler, une fois de plus, que le sang garde la mémoire du temps — une mémoire que la science sait désormais déchiffrer.
Nouhad Ourebzani